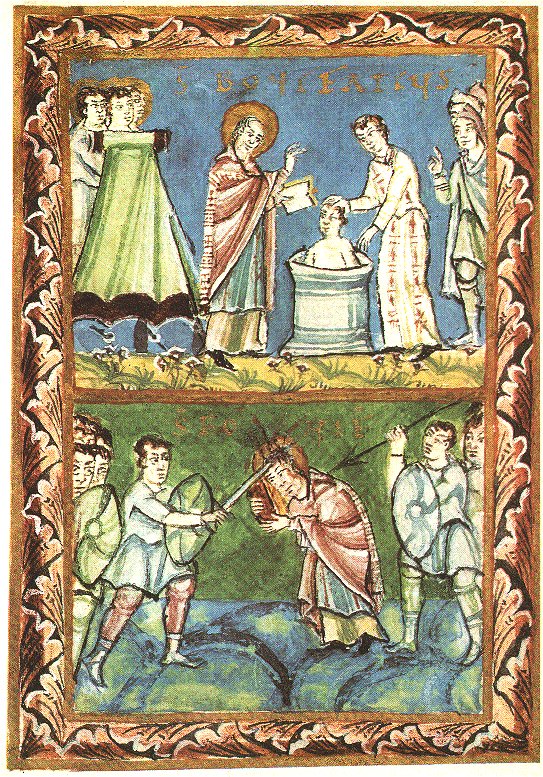J'ai déjà parlé des
femmes à Sparte et du cas particulier d'
Aspasie pour ce qui est de la condition de la femme en Grèce antique. Aujourd'hui, je vous présente mes notes sur un ouvrage de Pierre Brulé,
Les femmes grecques à l'époque classique (2001), dont vous pouvez lire une brève critique
ici.
En introduction, Pierre Brulé précise qu'on ne connaît la femme grecque seulement par des écrits d'homme, qui parlent autant des homme que des femmes. Le masculin est collectif (il s'incarne dans la cité) là où le féminin est individuel et intérieur. La femme grecque est toujours fille et épouse de, elle n'a pas vraiment d'identité en propre, elle est toujours définie par rapport aux hommes.
Chapitre I. Le féminin, les femmes et le sacré
Pierre Brulé envisage d'abord la piste religieuse pour comprendre la conception grecque du féminin, puisque la dichotomie entre hommes et femmes traverse aussi le divin.
Du féminin dans le divin
Le statut des déesses est à la frontière du sexuel, du biologique et du social.
La virginité d'Athéna, d'Artémis et d'Hestia est constitutive de leur état. Rêver d'un coït avec l'une de ces déesses est un présage de mort, alors que coucher en rêve avec un dieu est d'ordinaire une promesse de secours. Athéna représente le monde des hommes, Artémis celui des bêtes sauvages et des femmes en couche, Hestia le coeur de l'oikos (mot grec qui signifie le foyer, la maison). La virginité est le symbole de l'inviolabilité d'une place, or Artémis et Athéna sont des déesses guerrières.
Aphrodite dépasse les catégories homme/femme car elle embrasse toute la vie. Elle est épouse et mère mais n'est pas l'archétype de ces figures. C'est Héra qui est la figure de l'épouse par excellence, d'autant qu'elle est toujours liée à Zeus. Elle est à la fois l'amante et l'épouse trompée, acariâtre et jalouse.
Déméter représente la maternité (mèter, en grec, signifie mère) et la fécondité. Contrairement à d'autres déesses mères, elle a un lien fort avec sa fille Koré : elles sont appelées "les deux déesses" par les Grecs. Koré représente les oscillations de la femme grecque : elle est une enfant, elle se marie (symboliquement, en mangeant un pépin de grenade en enfer) et devient une adulte quand elle prend le nom de Perséphone.
Les principales déesses grecques sont donc diverses, mais l'homme reste le référent du féminin, puisque ces divinités sont définies par leur statut social et sexuel. Le féminin, d'autre part, est multiforme : Zeus et ses frères sont toujours représentés de la même manière, ce qui n'est pas le cas des déesses. Mais celles-ci ne sont jamais représentées vieilles car, si le vieillard est valorisé pour sa sagesse, la vieille femme suscite la répulsion. A Stymphale, on célèbre Héra pais (enfant), Héra teleia (accomplie car mariée) et Héra chèra (veuve) : les ruptures dans la vie des femmes dépendent des hommes.
Les humains en quête du divin
Il n'y a pas une religion féminine et une religion masculine en Grèce antique, mais les hommes contrôlent l'accès des femmes au divin. La communauté politique utilise à son profit les femmes comme actrices dans les rituels : les rites de Déméter, menés par les femmes, assurent ainsi la fécondité de la cité. La diversité des prêtres reflète celle des dieux : on donne des vierges aux déesses vierges, par exemple.
Les mythes montrent la femme comme dépendante de ses passions et comme problématique pour les hommes et les dieux : par exemple, un mythe affirme que la Pythie était auparavant une vierge, mais que cela comportait des risques (elle pouvait se laisser séduire par les hommes), donc on choisit ensuite une vieille femme qui doit s'habiller en vierge.
Dans les cortèges, les vierges vont en tête, car elles sont pures. Ces cortèges ont toujours lieu sous le regard des hommes, il n'y a pas de religion féminine.
Il existe en Grèce une fête à l'automne, dans laquelle les épouses de citoyens se rassemblent dans un sanctuaire hors de la cité pour célébrer Déméter et Koré pendant 3 jours. Les hommes sont exclus et les femmes dont des rites de fertilité. Dans les rites en rapport avec Dionysos, il y a aussi une prégnance du féminin : ces rites se font dans la montagne, avec des habits nouveaux, loin du foyer donc. Ces rites sont liés aux plaisirs, le foyer au travail domestique : on considère donc que les femmes qui refusent les rites de Dionysos sont stupides et qu'elles lancent un défi au dieu, qui peut les punir. Mais ces rites ont un caractère temporaire, localisé et ritualisé : ils ne sont pas un risque pour l'ordre social et pour les hommes. Ils consistent en une abolition des distances avec le dieu et la nature, qui passe notamment par le déchiquetement d'un animal.
Pierre Brulé parle d'une « théorie de la soupape » : les manifestations bachiques sont des compensations à la vie confinée du foyer. Les cultes à Déméter et à Dionysos ont un effet cathartique pour les femmes, mais ils se font aussi dans l'intérêt des hommes et de la cité.
Aux origines de la misogynie grecque
L'idée de la malveillance des femmes est une constante chez les Grecs. Simonide d'Amorgos, au milieu du VIIe siècle av. J.C., consacre un texte entier aux femmes, qui pour lui sont des sortes d'animaux sans esprit. Il compare les différents types de femmes à des animaux. Une femme sale et désordonnée est ainsi une femme-truie, une paresseuse une ânesse. Simonide pense que les femmes sont incapables de vertu, curieuses et toujours insatisfaites. La seule bonne femme est la femme abeille, qui travaille bien pour gérer les richesses et amène la prospérité. Mais même cette femme-abeille n'a pas de valeur en soi : ce qui compte, ce sont les richesses et les enfants qu'elle amène.
Chez Hésiode, Pandore est une beauté, mais son cœur est mauvais ; les femmes descendent d'elle. Elle représente la séduction. Le problème de la séduction, c'est que les hommes aussi s'y complaisent. Mais pour eux, ne pas se marier est aussi un problème car il faut avoir des enfants à qui léguer ses biens.
On pense que le ventre de la femme entraîne son intempérance en matière de sexualité et de nourriture ; la femme entraîne l'appauvrissement et la famine pour l'homme.
Il est étonnant de constater que dans les comédies du IIIe siècle av. J.C., les maîtresses de maison adressent à leurs esclaves les mêmes propos misogynes que les hommes.
Chapitre II. Silhouettes de femmes dans l'épopée
Chez Homère, les femmes sont épouses ou filles : elles se définissent par rapport à l'homme et par rapport à leur âge.
Femmes de l'Iliade : Briséis et Chryséis
Briséis et Chryséis sont l’image l’une de l’autre : elles sont les filles de deux rois-prêtres frères, leurs maris ont été tués par Achille (Briséis) et Agamemnon (Chryséis), elles sont des parts de butin. Agamemnon doit rendre Chryséis à Apollon et prend Briséis à Achille : les deux jeunes filles sont interchangeables. Dans d’autres traditions, Chryséis se nomme Astynomé (la loi de la ville) et Briséis Hippodamie (la cavale domptée) : elles changent de nom après la mort de leur mari. Chryséis signifie celle-de-Chrysa et fille-de-Chrysès Briséis celle-de-Brisa et fille-de-Brisès : il y a une idée de provenance et d’appartenance. Le nom de Chryséis évoque l’or, et donc sa blondeur, sa richesse et son érotisme ; le nom de Briséis évoque le verbe brithô qui désigne ce qui est chargé de fruits : elles sont des trésors.
Briséis et Chryséis ont les mêmes états : elles sont vierges, puis mariées, puis veuves et parts butin. Mais elles ne sont pas évoquées par les mêmes catégories. On insiste sur le sexe, la jeunesse et la filiation de Briséis. Chryséis est surtout « fille de Chrysès », on insiste sur son état social et sexuel, mais les personnages et le narrateur ont des mots tendres pour elle. Elle est appelée trois fois
pais (enfant)
alors que le mot est rare au féminin dans l’
Iliade, ce qui signale un lien affectif plus qu’un âge. Le mot thugater (fille, par rapport au père) est fréquent dans l’
Iliade où les héros sont pris entre un individualisme forcené et leur parenté ; le mot est appliqué à Athéna, aux Muses ou à Héra, qui ont pourtant des rôles sociaux et sexuels différents ; le mot persiste après le mariage. Dans l’
Iliade, les
thugatres (filles, par rapport au père) sont une collectivité ; c'est le mariage fait de la fille une femme individualisée, mais avec une généalogie continuée.
Chrysès offre à Agamemnon une rançon pour sa fille Chryséis, sur un cratère du milieu du IVe siècle av. J.C. (
source)
Briséis est désignée comme une épouse aimée par Achille ; elle représente le féminin adulte, contrairement à Chryséis. Agamemnon la rend à Achille avec des cadeaux, sans l’avoir touchée ; la scène équivaut symboliquement à un mariage. Briséis voit le cadavre de Patrocle et prend le rôle d’une femme adulte avec ses lamentations rituelles. Elle évoque son attirance pour Achille : elle est sa compagne, pas une fille-de. Chryséis reste la fille-de-son-père car Chrysès est encore vivant (alors que Brisès est mort). Il y a toujours un lien, Chrysès garde son autorité ; Chryséis n’est jamais une femme. Le droit du père est toujours important à l’époque classique : le père peut reprendre sa fille au mari avant la naissance du premier enfant (ou du premier garçon), l'autorité du père est supérieure à celle du mari.
Femmes de l'Odyssée : Nausicaa, la parthenos [vierge]...
Nausicaa est une jeune fille, une thugater quand on évoque sa filiation avec son père Alkinoos ou sa mère Arété. Alkinoos est le modèle du roi et du père, Arété celui de la maîtresse de maison et de la mère. Alkinoos appelle sa fille pais, ce qui est affectueux. On insiste sur la parenté et sur le sexe de Nausicaa, qui est en pleine transformation (jeune adolescente, juste avant son mariage).
Nausicaa apparaît au milieu de ses servantes : elle est une cheffe de choeur, comme Artémis au milieu de ses nymphes. La beauté de Nausicaa est décrite de manière très conventionnelle. Mais elle est comparée à un palmier, ce qui dénote la vigueur, l'élan, et donne une image biologique et sexuée de la vierge (le mot grec signifiant palmier évoque aussi ce qui fleurit, ce qui éclot).
La jeune vierge est dite admès (indomptée, sans maître) : les filles prépubères sont souvent comparées à des animaux, la vierge est un animal sauvage dompté par son mari, par les responsabilités du foyer et par de nouvelles contraintes. La raison de vivre de la vierge, c'est le mariage. Alkinoos propose de donner sa fille à Ulysse, mais de garder Ulysse en Phéacie - l'île sur laquelle il habite - alors que le mariage grec est virilocal.
... et Pénélope, femme d'un seul homme
Il existe un concours matrimonial : il y a une compétition entre les hommes pour obtenir l’assentiment d’un autre homme, le père. Chez Homère, les familles donnent et reçoivent des femmes, mais c’est un idéal : il y a des foyers sans filles (c’est moins grave que s’il n’y a pas de garçon), mais la thugater a un rôle important dans ce vaste échange. Il faut noter l'importance du don chez Homère : celui qui prétend à une thugater doit faire étalage de sa richesse et faire des dons au père et à la fille ; c'est le plus offrant qui l’emporte. La fille exprime l’excellence de sa maison d’origine. Elle est enrichie par son père et son futur époux. Le père (donneur) paye (dot) pour que sa fille parte : pourquoi ? La légitimité du mariage vient de l'échange de richesses : les richesses de la femme la suivent. Mais la vision économique, à laquelle chaque famille doit participer pour ne pas bloquer le système, n’est pas une explication suffisante, étant donnée l’intensité du rapport père-fille. Il existe une autre hypothèse : le père espère une descendance de sa fille, car la parenté maternelle n’est pas négligeable chez Homère. Ou bien le père paierait-il pour se débarrasser d’une bouche à nourrir ?
Dans le foyer d'Ulysse, Pénélope est courtisée par des hommes ; son fils Télémaque est trop jeune pour régner ; Pénélope n’a pas l’autorité d’un homme et ne peut posséder. Elle est considérée comme veuve, elle fait partie des biens du foyer à sauver. Les prétendants offrent pour séduire Pénélope et Télémaque, pour que Télémaque majeur puisse donner sa mère au plus offrant, comme s'il était son père. Pénélope est une femme libre de ses choix car elle n’a plus de tuteur naturel (Ulysse) ni de tuteur virtuel (Télémaque). Elle peut retourner chez son père avec ses richesses. Pénélope est la fille d’Icare, à la fois épouse, mère, maîtresse de maison et tisseuse hors pair. Elle est « prête à suivre un Achéen » : est-elle plus attachée au mariage qu’au mari ? La femme de l’épopée dirige la maison et œuvre à la satisfaction des besoins des autres.
Pénélope attendant Ulysse, vue par Domenico Beccafumi, un artiste du début du XVIe siècle (
source)
Pour les Grecs, Homère dit la vérité sur le passé. Pour nous, les usages qu’il décrit sont souvent analogues à des pratiques postérieures : il y a donc une certaine réalité dans ce qu’il décrit, mais les comportements épurés de l’épopée ne sont pas un reflet de la réalité.
Chapitre III. Du corps et du comportement
La science grecque est liée à un imaginaire : elle a une conception a priori du féminin et fait une lecture idéologique du corps. La femme représente l'intérieur, l'homme l'extérieur.
La parole aux « spécialistes »
La biologie, à l'époque classiaque (Ve - IVe siècle av. J.C.), se base sur les œuvres biologiques d’Aristote et sur le corpus hippocratique. On pense qu'il n’y a qu’une différence de degré entre l’homme et l’animal. La femme est la « femelle des femelles », elle est un antonyme de l’homme grec (comme les Barbares, les jeunes…). Le mâle représente le courage, la femme la mollesse et la pâleur, elle est considérée comme biologiquement proche de l’esclave.
Mais il existe des femelles courageuses (comme l'ourse) : le réel ne suit pas toujours le schéma général mais l’idéologie prend le pas. Ainsi, l’ourse a quatre mamelles et donne forme à ses petits : elle est tout de même une incarnation de la féminité. Pour Aristote, les abeilles ouvrières ne sont pas des femelles car elles sont armées (dard) ; les bourdons ne sont pas des mâles car ils sont désarmés. Mais l’inverse est impossible car les ouvrières s’occupent des petits (ce qui n'est pas un attribut du mâle) : pour lui, les abeilles ne naissent pas d’un accouplement, elles sont un troisième genre. Les changements de rôle induisent une modification morphologique, et inversement : l’eunuque est proche de la femme.
La voix est l’organe du commandement et de la politique. La femme a donc une voix faible, portée aux plaintes, à l'incivilité et à la déficience, comme les jeunes, les vieux et les malades. Le grave est bon, l'aigu mauvais. Le corps de la femme est faible. La femme barbare ou esclave accumule les tares. Mais une femelle castrée ne se rapproche pas du mâle, elle s’en éloigne encore plus, « toute régression est donc femelle » : la femme n’est pas l’antivaleur de l’homme mais un mâle inférieur, un écart de la nature pour Aristote, un être eunuque.
La femme, c'est la mollesse et l'humidité du corps et de la peau. « Plus on est féminin, plus on est poreux ». La culture s'incarne dans l'homme, qui est mouvement, action, vigueur, et représente l'extérieur. La femme étant couarde, elle est donc vigilante et garde l'intérieur. L’anatomie est liée aux activités et inversement.
La femme est considérée comme très humide et très sanguine. Le sang est la nourriture du fœtus, d’où son abondance chez la femme (règles). « Le sang féminin interfère avec le sacré » : les règles sont une souillure, elles peuvent contaminer le mâle et altèrent même le métal ! En cas d'absence de règles, on croit que le sang s’accumule ailleurs. C’est le cas chez la vierge, d'autant que les premières règles ne peuvent s'écouler à cause de l'hymen : on pense que le sang remonte vers le diaphragme et le cœur, compression, ce qui engendre épilepsie, suicide et morbidité. La solution, c'est de se marier jeune. Chez les femmes adultes, la rétention de sang est censée créer des dérangements mentaux.
Pour les médecins, le sperme est le produit de la coction du sang. Pour Aristote, les règles ont la même nature que le sperme, mais elles constituent un « sous-sperme ». La femelle étant « l’être qui engendre en soi », elle est associée à la Terre Mère, à l'attente, au corps, alors que le Ciel Père est un vecteur et un mouvement. Pour Aristote, le corps du bébé est fourni par la femme, l’âme par l’homme.
Si l'activité sexuelle est trop grande, cela entraîne trop de coction et est donc mauvais pour la santé. La femme est considérée comme lascive, on pense donc qu'elle produit plus de sperme et que c'est pour cela qu'elle vit moins longtemps. La densité du sperme masculin s'oppose à la mollesse du sperme féminin. Durant la grossesse, on pense que la fille se développe moins vite. Mais la puberté arrive plus tôt chez les filles : on estime donc qu'elles peuvent donc se marier plus vite, et qu'elles meurent plus jeunes car elles sont plus sanguines, spermatiques et lascives : elles perdent leur avantage de précocité par un mauvais régime.
La différence de sexe est essentielle, il y a une séparation radicale entre hommes et femmes.
La sexualité
L'homme incarne la polyvalence sexuelle : il a une sexualité politique qui vise à la reproduction, et une sexualité récréative (souvent homosexuelle à Athènes). La sexualité féminine dépend de la polyvalence de celle des hommes, et de la différence d'âge au mariage.
Selon le
mythe du Banquet, Zeus fait en sorte qu'il y ait une possible reproduction de l'espèce (en faisant aller les moitiés hommes vers les moitiés femmes), mais il y a quand même satiété dans les relations homosexuelles (même si elles ne mènent pas à la reproduction) afin de faire diminuer la passion et de favoriser l’action. Les hommes qui aiment les hommes sont les plus virils de nature, car ils proviennent d’un être entièrement homme. Ces hommes se tournent vers le mariage par nécessité, pour la cité. Ce mythe est le reflet de la conception de la sexualité.
Les médecins et les auteurs comiques soulignent le dérèglement sexuel de la femme, dû aux maladies de l’utérus, qui est un animal mobile avec des besoins. La femme n’a pas d’autorité sur lui. L’utérus souffre et s’assèche s'il n'y a pas de rapports sexuels ou de grossesse : le sperme le guérit en l’humidifiant. La femme est malade de son corps chez les comiques. Pour l'homme, l'attirance s'exprime avec le verbe philein (aimer), alors que pour la femme, on utilise des mots en rapport avec les chaleurs animales. Sur scène, la truie représente la femme (surtout la vieille lubrique). L’homme a du plaisir mais n’en abuse pas, l’excès est féminin : l'homme a peur du ventre féminin qui dévore.
Les hommes « manifestent publiquement l’intensité de leur libido », le vocabulaire est celui du plaisir, de la gaieté de l’acte sexuel, et du mouvement de l’homme vers la femme. On utilise en particulier des métaphores agricoles pour l’homme (labours). Le sexe féminin est une prairie, une plaine, un jardin, une figue.
On souligne la félicité du plaisir hétérosexuel, mais on trouve aussi le thème omniprésent de la violence. La femme est comme une esclave : c'est une femme-objet dont on prend possession, il y a une mise sous contrôle du corps féminin. Dans le traité des rêves d’Artémidore, pénétrer ou posséder signifie prendre du plaisir et est symbole de vie, tandis qu'être pénétré est synonyme de corruption, de souillure et de mort.
L’homme qui fuit au combat est considéré comme un faux homme, un eunuque, une femme. Les invertis et les passifs sont vils. La sodomie hétérosexuelle est réservée aux prostituées, et les fesses de l’homosexuel sont comparées au sexe d’une femme : il y a une idée de domination du mâle adulte. Les Perses vaincus sont comparés à des hommes soumis. L’homme adultère ou soumis à ses passions est comme une femme, car ne pas contrôler ses pulsions est féminin.
Dans l’amour vénal, les femmes sont souvent actives ; les clients peuvent les fouetter si elles faiblissent. Il existe deux figures de la masturbation en Grèce : Diogène le Cynique qui s'exhibe et affirme qu'’il est mieux de se faire masturber (on utilise des esclaves pour les taches basses), et les godemichés utilisés par les prostituées et les épouses. La sexualité féminine est un fantasme masculin. Dans l'iconographie : la femme masturbe l’homme, pas l’inverse. Les hommes considèrent comme féminin l’abandon à la luxure. La première cause de cela est que les femmes ne maîtrisent pas assez leur corps alors qu’on l’exige d’elles. La seconde cause est l'« angoisse existentielle » de l’homme grec devant le comportement de la femme. Certains pensent que le plaisir est nécessaire à la fécondation. Plus une femme est femme (pâleur et apparence féminine), plus elle jouit. Le plaisir dépend toujours de l’homme. Le plaisir vaginal est le seul considéré chez les Hippocratiques, car on se focalise sur la reproduction. Mais le clitoris et ses effets sont connus.
Chapitre IV. L'oikos de Périclès : gloire et misère de la vie conjugale
Il n'y a pas de femme hors de l'oikos (foyer), et pas d'oikos sans femme, le fonctionnement des oikoi dépend de la circulation des femmes. Plutarque, dans la Vie de Périclès, évoque les 3 caractéristiques essentielles du mariage athénien à l’époque classique :
1. La femme de Périclès n’est pas nommée, on ne nomme pas les femmes de l’oikos, elles ne sont connues que par les rapports de parenté (on ne nomme que les prostituées, les esclaves et les mortes),
2. Il y a endogamie, on se marie à l'intérieur de sa classe sociale,
3. Plusieurs noces sont possibles, la femme peut passer d’un oikos à l’autre.
D... de main en main : les grandes familles font tourner les femmes
L'épouse de Périclès pourrait s’appeler Deinomaché, mais nous n'en sommes pas sûrs. On lui fait contracter un mariage avec un Kéryke (une famille riche qui a un rôle politique), Hipponikos. Le mariage est un moyen d’ascension sociale, même si la famille de D… est déjà prestigieuse. D... est ensuite mariée à Périclès, et Plutarque dit qu’il y a un divorce par consentement mutuel entre Périclès et D… Périclès est magnanime, il augmente la dot de D… pour la remarier. Elle se remarie avec Kleinias, dont elle a Alcibiade. Le premier mari de D… a eu une autre épouse qui lui a donné une fille, Hipparété, future épouse d’Alcibiade.
Y a-t-il la même endogamie dans les basses classes sociales ? C’est possible. On se marie entre soi, socialement et génétiquement. Pierre Brulé parle d'une « géométrie sociale dynamique » : il y a une circulation des femmes et des richesses dans un système patrilinéaire. Les femmes sont des « rameaux détachés de leur propre tronc paternel [qui] vont, successivement, faire des fruits ailleurs ».
Buste de Périclès.
Le mariage d'époque classique : un accord entre deux hommes
La raison du mariage, c'est de faire d’une femme une épouse légitime pour qu’elle donne des enfants légitimes. Le mariage se fait en deux temps : il y a d'abord la dation par contrat (ekdosis), qui nécessite la présence de témoins, puis la célébration tangible, le gamos. Juridiquement, le mariage est un accord entre deux hommes à propos d’une femme, pas forcément présente, qui implique un transfert d’autorité. Mais le rapport père-fille est toujours fort, le père peut reprendre la fille si elle n’a pas encore d’enfant qui la rattache définitivement à son nouvel oikos. Il n'y a pas de compétition comme dans l’épopée, car il y a une dévalorisation de l’institution et de l’épouse par rapport à Homère.
Un mariage officiel nécessite une dot (mais il existe des exceptions, comme Socrate et Myrtô). La dot fonctionne comme une barrière, elle participe à l'exclusion des filles pauvres du marché matrimonial (des hommes pauvres aussi). La cité dote les filles les plus pauvres car le célibat est une menace. La dot est aussi un marqueur social, même dans les relations conjugales. Elle est faite d’argent, richesses invisibles et mobiles. Au IVe siècle av. J.C., la dot représente entre 5 et 25% de la fortune du père (pour une seule fille) ; on vend parfois des biens pour doter des filles, au détriment de l’héritage masculin ; ou bien on ne dote pas certaines filles et on les laisse « se consumer au fond de la demeure obscure ». La dot suit la femme, elle ne peut pas y toucher mais son mari n’en a que l’usufruit, il y a hypothèque s’il ne peut rendre la dot en cas de divorce. L’argent de la dot fait partie de l’héritage des fils. Il y a donc une permanence sur plusieurs générations : dot de la mère → héritage du fils → dot de la fille. Les terres passent uniquement par les hommes. La dot permet la mise en valeur de la filiation féminine, et garantit à la femme qu'elle pourra retrouver un nouvel oikos. La dot peut être un frein, un père doit parfois attendre la mort de sa mère pour doter ses filles.
La dot d'Hipparété, l'épouse d'Alcibiade, représente 10 talents (c'est la plus grosse dot connue), accompagnée de 10 autres talents à la naissance d’un enfant (ou d'un fils ?) : la vraie raison du mariage pour le père de la mariée, c'est d'avoir des petits-enfants. Hipparété retourne chez son frère car elle est trompée et malheureuse ; elle demande le divorce à l’archonte, elle n'a pas une nullité juridique. Mais Alcibiade la ramène de force chez lui, sa tutelle est forte et il ne veut pas rendre la dot. Hipparété meurt peu après.
La jeune épousée est une nymphe ; elle est très jeune et considérée comme assez sauvage. Elle n'a aucune autorité sur elle-même (tutelle du père) ; la mère lui a appris à être sage. Aristote et Platon préconisent le mariage des filles entre 16 et 20 ans, car il y a des dégâts sur la mère et les enfants si le mariage a lieu plus tôt. La jeune fille passe de l’enfance à l’âge adulte (épouse), elle n'a pas d’adolescence. L'âge de la fille au mariage correspond plus ou moins à l'âge des éromènes, les jeunes garçons avec qui les hommes plus vieux ont des relations. A Thasos, on offre aux orphelins un équipement guerrier, aux orphelines une dot à 14 ans ; à Athènes, une procédure vise à trouver un mari à la fille épiclère à 14 ans (la fille épiclère est celle qui hérite de son père en l'absence d'héritiers mâles).
Les hommes se marient plus tard, vers 30 ans. Avant, ils ont des partenaires masculins ou vont voir des prostituées. L'écart entre les mariés est de 15 à 20 ans. Les hommes aiment la douceur et la blancheur chez les aimés, qu’ils soient hommes ou femmes. La pédérastie est forcément éphémère, car l’éromène vieillit. Dans l’Anthologie Palatine, on loue la beauté des filles et des garçons, qui ont un ennemi commun, le poil, symbole de la puberté. Aristote dit que « l’enfant a une forme féminine » : il y a une même esthétique et un même érotisme chez les jeunes des deux sexes.
Les filles sont souvent tuées à la naissance. On expose les garçons et les filles si l’enfant est le fruit d’un adultère, l'enfant d'une vierge séduite ou s’il présente des tares physiques, mais ces phénomènes ont des conséquences démographiques négligeables. Mais avec le contrôle de naissances des filles, qui représentent une dot et une bouche à nourrir, il semble qu’il manque une fille sur deux par rapport aux garçons avant la puberté : c'est un fait démographique important, qui peut expliquer lemariage tardif pour les hommes (qui sont moins nombreux à mesure qu'ils vieillissent). Le mariage est vu comme transitoire, c’est un service à la cité qui prend fin avec la fin de la fécondité.
Le cas de Socrate : pendant la guerre du Péloponnèse (-431 / -404), un décret stipule que les Athéniens peuvent avoir deux femmes car on manque d'hommes. Mais une seule sera l’épouse, d’origine athénienne, même si la deuxième fournit quand même des enfants légitimes. Socrate a une épouse officielle, Myrtô (qui n'a pas de dot), et une deuxième femme, Xanthippe, présente avant Myrtô.
Le gamos, fête nocturne
La cérémonie de mariage est marquée par trois rituels : la séparation d'avec la famille, le transfert (cortège nuptial) et l'intégration dans un nouvel oikos. La jeune mariée offre sa chevelure à Artémis, qui veille sur la procréation ; on abandonne aussi à la déesse des sous-vêtements et des tambourins (car on quitte les chœurs de vierges pour entrer dans d’autres groupes cultuels).
Les divinités du gamos sont Zeus Téléios et Héra Téléia, le couple modèle, accompli, et Aphrodite avec Peithô, qui symbolisent la relation charnelle et la séduction ; Artémis représente la fin de l'enfance et la procréation. En grec, « être mise sous le joug » signifie être épousée. Les jeunes filles offrent à Artémis ce qui a un caractère sauvage : rupture avec Artémis. Pour accéder au thalamos (chambre nuptiale), il faut être pure : il y a un rite de purification avec de l'eau.
Avant le repas, on sacrifie aux dieux du gamos et à d’autres, selon les cités. Le repas a lieu chez le père de la fille, avec la famille de l’époux. Il y a des tables pour les hommes et des tables pour les femmes. La nymphe n’arrive qu’à la fin du repas, elle ôte son voile et reçoit des cadeaux du marié. Le cortège est la partie publique de la cérémonie : ainsi, le groupe social reconnaît le statut des futurs enfants ; c'est aussi un accomplissement physique du rite ; le cortège est accompagné de flambeaux (un « mariage sans flambeaux » est un mariage clandestin). La nymphe ne doit pas toucher le seuil de son nouvel oikos. Elle prend symboliquement possession des objets liés au nouveau rôle social de la nymphe, ce qui symbolise son nouveau pouvoir sur l’oikos. Le lendemain, il y a un nouveau cortège, avec des cadeaux de la famille de la fille.
Chapitre V. La femme dans l'oikos : l'épouse d'Ischomaque
Des raisons pour vivre ensemble
Ischomaque est un homme riche, un aristocrate, un homme plus doué pour l'action que pour la parole. Il est un des personnages de l'Economique (un traité de Xénophon sur la manière de tenir sa maison et son épouse), mais a réellement existé. On ne connaît pas le nom de sa femme. L'épouse est une collaboratrice et une mère. Les parents de la nymphe et le mari ont le même but : que la jeune fille ait des enfants.
Ischomaque a de l'attirance et de l'amour pour sa femme ; il est normal, pour les Grecs, d'aimer son épouse. Mais l’homme parle plus à tout le monde qu’à sa meilleure associée ; l’essentiel de sa vie est lié aux autres hommes, tandis que pour la femme, son mari et l’oikos sont toute sa vie ; l’essentiel de la vie de l’homme est liée au célibat. Le mari nourrit l’épouse-mère pour qu’elle nourrisse des enfants. L'union sexuelle permet de s’assurer des soutiens pour la vieillesse, l’enfant nourrira ses parents : c'est un facteur de cohésion sociale. Les activités de production de l’oikos sont dévolues aux filles.
Oikos et cité, en miroir
L’homme grec « rentre toujours du dehors » : c'est le maître de son oikos, et il participe à l’administration de la cité, qui est comme un autre oikos. L’homme est chez lui un despote, mais dans la cité, il est un citoyen qui débat en ville : il y a une stricte séparation entre le privé et le public.
Le citoyen doit maintenir le potentiel militaire de la cité en faisant des enfants, mais l’homme n’est pas forcément porté à la reproduction. La cité lutte contre le célibat : une loi oblige le mari d’une épiclère à coucher avec elle au moins trois fois par mois ! La transmission des terres va de pair avec celle de la citoyenneté : la disparition d’un oikos signifie la disparition d’un citoyen, d’un potentiel, de terres, de la mémoire… L’épouse doit toujours être prête à être fécondée, d’où l’attention des médecins à la femme. Mais une trop grande fécondité génère une famille trop grande (donc un plus grand partage de l'héritage). Il existe des méthodes pour éviter les enfants, comme le coït interrompu, qui sont essentiellement les affaires de la femme.
Quand un citoyen n'a que des filles, il peut adopter de garçons ou se résoudre à ce que sa fille hérité (épiclérat). On expose les filles, on leur donne moins de soins et moins de nourriture, elles sont mises au travail plus jeunes, ce qui crée des déficiences.
La femme d'Ischomaque est la reine des abeilles
L'homme acquiert des biens, la femme les conserve. Les buts de la vie d'une femme sont le travail, l'enfantement et les responsabilités : la nymphe vieillit vite et a toujours peur que son mari se détache d’elle (d’où des recours à la magie pour l’éviter). C'est un problème de la position sociale, la femme dépend de l’homme. L’homme peut avoir des concubines dans son oikos. Ischomaque pense qu'il n'y a pas de risque que la considération du mari baisse si la femme accomplit son devoir. La nature de la femme la rend apte à gérer la maison (elle n’est pas courageuse donc elle est attentive). Seules les femmes pauvres vont à l’agora, par obligation, la femme est normalement cantonnée à l'intérieur.
Ischomaque est pour sa femme un précepteur, car il est plus vieux, détient l'autorité et a l'habitude de commander. Son épouse est troublée à son arrivée, elle subit un choc et reste longtemps muette. La femme est la gardienne des lois ; la femme vertueuse se rapproche de l'homme, la vertu est un signe de virilité. Les auteurs comique dénoncent l'« autocratie domestique » de la femme.
L'épouse est une travailleuse, mais son travail est caché. Il y a des tensions à la fin de la guerre du Péloponnèse à Athènes (-404) : il y a beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes, car beaucoup sont morts ou absents. Les femmes se concentrent dans dans un même oikos, on recueille des femmes de sa parenté : faut-il les faire travailler ?
La majorité des textiles grecs sont faits par les femmes dans l’oikos, pour les membres de l’oikos. Le travail se fait en commun (femmes de tous les âges, esclaves et libres) : il y a une sociabilité des femmes dans l’oikos, même s’il y a sûrement un partage des tâches. Le travail textile est symbolique, il existe même dans les plus hautes classes, c'est le symbole du travail de la femme. Chez Aristote, l'épouse idéale est belle, tempérante et aime le travail gratuit.
Femme grecque filant la laine, début du Ve siècle av. J.C. (
source)
La laine est le symbole par excellence de la femme grecque.
L'Economique est le « récit de la mise sous le joug d’une nymphe par son mari ». Dans un autre texte, on nous parle d’un Ischomaque (mais on ne sait pas si c'est le même) dont la veuve Chrésylla est une mégère. La dot de la veuve la rend moins dépendante, le remariage se fait dans des conditions très différentes du mariage. Avec le décret de Périclès en -451/-450, l’épouse d'un citoyen athénien doit être athénienne, on exclut les autres, ce qui crée une hausse de l’endogamie.
Chapitre VI. Femmes du dehors : d'Aspasie à Nééra
Les hommes parlent peu des esclaves et des femmes libres qui échappent au système de l’oikos. Mais on possède de nombreuses anecdotes sur quelques hétaïres qui ne sont pas anonymes (contrairement aux épouses).
Le lexique de la prostitution
L'hétaïre est une amie (hétaïra signifie compagne) mais aussi une courtisane, un peu comme les geishas : elle n'a pas le statut de la femme légitime, c'est plutôt une plutôt maîtresse et une concubine. La pallakè est une maîtresse ; le mot implique l'idée de régularité et de préférence du concubin ; la pallakè est entretenue par son protecteur. La pornè est une prostituée qui se vend.
Le mot hétaïre connote l'idée de plaisir (hédonè), mais ce plaisir n'est pas uniquement sexuel : les hétaïres, comme Aspasie, tiennent des salons où l'on écoute de la musique et où on récite de la poésie. Les revenus dépendent de l'attention accordée au client. Se pose la question de la catégorie juridique : ces femmes sont-elles libres ou esclaves ? Athéniennes ou étrangères ?
[je passe les quelques pages sur Aspasie, dont je me suis déjà beaucoup inspiré
ici]
L'autre Aspasie : le modèle grec à la conquête des Perses
Aspasie (celle de Périclès) est célèbre : Cyrus donne le nom d'Aspasie à sa concubine préférée. Le vrai nom de cette femme est Miltô. Elle naît à Phocée, est pauvre et orpheline de mère. Elle se distingue par sa maîtrise et sa fermeté, qui sont des qualités viriles. Elle devient très belle et naturelle (alors que les femmes sont connues pour leurs artifices). Elle est convoquée pour un banquet chez Cyrus, le frère du roi des Perses, qui gouverne la région ; son père refuse, il veut protéger la vertu de sa fille, mais Cyrus emploie la force. On amène quatre filles à Cyrus, dont Miltô, qui a refusé les vêtements et les fards, contrairement aux trois autres qui intriguent pour séduire Cyrus. Miltô se révolte, elle invoque les dieux grecs et sa liberté ; mais on la force à céder, elle doit prendre les vêtements, ce qui équivaut à une prise de fonction (comme son changement de nom). Elle se révolte quand Cyrus la touche ; il est charmé et la retient seule. On assiste ensuite à la naissance d’un amour réciproque. Cyrus est très grec, comme Aspasie II. Les deux Aspasie sont Ioniennes (l'Ionie région grecque d'Asie mineure), sages, et sont des mentors pour leurs amants. Aspasie II a également la noblesse et des qualités masculines.
A la mort de Cyrus qui s'est rebellé contre son frère, Aspasie fait partie du butin d’Artaxerxès, qui s’indigne qu’elle soit attachée ; on lui apporte des habits magnifiques. Aspasie devient la maîtresse du Grand Roi (nom que l'on donne au roi des Perses). Puis Darius, l'héritier du trône, demande à son père quelque chose qu’il n’a pas le droit de refuser : il demande Aspasie. Artaxerxès pose comme condition l’accord d’Aspasie, et elle accepte, ce qui est le signe de son habileté politique. Mais Artaxerxès la nomme prêtresse, ce qui l'oblige à la chasteté. A la mort du mignon du Grand Roi, tout le monde est en deuil pour plaire au roi, mais personne n’ose le consoler ; Aspasie se met sur son chemin en habits de deuil et pleure. Artaxerxès est touché, il l’amène chez lui et lui passe l’habit du mignon (eunuque) : Aspasie joue sur l’ambiguïté pour susciter le désir.
Nééra, à l'assaut des oikoi
Nééra est une femme très libre, accusée d'avoir épousé l’Athénien Stéphanos alors qu’elle était étrangère ; elle doit être vendue en esclavage. L’accusateur doit prouver qu’elle est étrangère et mariée à Stéphanos, il retrace donc son parcours.
Nééra est achetée, encore impubère, par Nicarété, une ancienne esclave devenue maquerelle ; Nicarété la prostitue et fait croire aux Athéniens qu'elle est libre, car cela attire les citoyens. Mais Nééra est une esclave. L’argent du client va surtout à Nicarété, qui n’est pas du même monde qu’Aspasie. La fille dépend de celle qui l’a achetée et de celui qui l’utilise, qui peut la louer.
Nicarété n’est pas citoyenne, elle ne peut pas posséder de biens fonciers : elle loue un toit à un citoyen qui ne se salit pas les mains mais possède la maison. Nééra voyage beaucoup avec Nicarété ou avec des clients ; sa mobilité s'oppose à la stabilité de l’épouse et lui permet de se créer un réseau.
Deux hommes veulent acheter Nééra ensemble car ses passes sont devenues trop chères. Nicarété est d’accord (peut-être parce que Nééra vieillit et risque de tomber enceinte). Nééra a désormais une certaine indépendance économique, elle est une concurrente sexuelle pour les épouses, elle travaille seule ou choisit des associées. Mais les deux hommes se marient et ne veulent plus d’elle : ils veulent bien l’affranchir si elle rembourse les 30 mines qu’elle a coûtées (mais les hommes baissent à 20).
Nééra fait venir d’anciens amants qui lui font des dons, qu’elle confie à un certain Phrynion en lui demandant de compléter, pour racheter sa liberté. Phrynion accepte et emmène Nééra à Athènes. Nééra prend son indépendance par rapport à Phrynion, va à Mégare en emportant des bijoux, des vêtements et deux servantes de Phrynion. Mais son commerce est mauvais. Stéphanos, un client, arrive. Nééra est indépendante mais elle doit prendre un patron (Phrynion normalement) : elle choisit Stéphanos, à Athènes. Stéphanos veut introduire les enfants de Nééra dans sa
phratrie ; Nééra apporte des cadeaux (qui équivalent à une dot) et ils se marient. Stéphanos devient maquereau, le prix de Nééra est plus haut car elle passe pour libre, tout comme sa fille Phanô ; les hommes ont un goût prononcés pour les femmes « respectables » (libres). Phrynion la rattrape, elle doit rendre ce qu’elle a pris, et Phrynion et Stéphanos se partagent Nééra selon le jour.
Stéphanos présente Phanô comme la fille d’une épouse athénienne antérieure, et la marie avec Phrastôr. Mais Phrastôr renvoie Phanô enceinte, sans sa dot, lorsqu’il découvre la vérité. Nééra et Phanô vont assister Phrastôr malade : celui-ci reconnaît le garçon qui naît, mais sa phratrie ne le fait pas. L'intégration échoue.
Stéphanos a aidé un citoyen pauvre, Théogénès, qui est ensuite désigné archonte-roi ; Stéphanos lui offre sa « fille » Phanô. La fête des Anthestéries comporte un hieros gamos (union sacrée) entre Dionysos et l’épouse de l’archonte-roi ; la première condition de ces rites est la pureté. Or Phanô a une vie licencieuse, elle est adultère, et cela représente un danger pour les rites. La loi sur l’adultère stipule que l’époux doit répudier une femme adultère, sinon il est exclu de la communauté politique ; la femme adultère est exclue des cérémonies publiques (même les esclaves peuvent y participer).
Si Nééra perd le procès, elle deviendra esclave, alors qu’elle a une bonne situation matérielle. Elle n’a pas réussi à intégrer le « groupe de reproduction politique », alors que d’autres si. On ne connaît pas le verdict du procès.